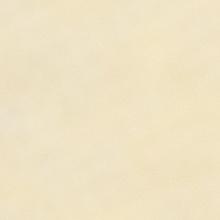April 22, 2025

De gauche à droite: Mouloud Boumghar, la Rapporteuse spéciale Mary Lawlor, Monia Ben Jemia, Nassera Dutour et Zakaria Hannache abordent la répression de l’espace civique en Algérie durant un évènement au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 7 mars 2025.
L’évènement était co-organisé par Article 19, Cairo Institute for Human Rights Studies, Amnesty International, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et Human Rights Watch. Le panel était composé d’expert·es en droits humains et de représentant·es de la société civile algérienne. Parmi les intervenant·es figuraient Mary Lawlor, Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des défenseur·es des droits humains, Zakaria Hannache, militant engagé dans la défense des droits fondamentaux, Mouloud Boumghar, professeur de droit public, et Nassera Dutour, présidente du Collectif des Familles de Disparu·e·s en Algérie. La discussion a été animée par Monia Ben Jemia, présidente d’EuroMed Rights.
Dans ses remarques d’ouverture, Monia Ben Jemia a dénoncé la répression croissante des libertés fondamentales en Algérie. Elle a souligné les tactiques autoritaires des autorités, notamment le contrôle du pouvoir judiciaire, l’usage détourné de la législation antiterroriste et les obstacles imposés aux ONG. « Ces stratégies de musèlement sont celles de tous les régimes autoritaires, nous les connaissons », a-t-elle déclaré avant le laisser la parole aux panélistes.
Un appel aux autorités algériennes à se conformer aux standards internationaux
Première intervenante à prendre la parole, Mary Lawlor a souligné que malgré les assurances des autorités algériennes, aucune amélioration concrète de la situation des défenseurs des droits n’a été constatée depuis sa visite en Algérie.
Elle a constaté que les défenseurs des droits humains qui travaillent sur les droits économiques avec les organisations gouvernementales disposent d’un espace et d’une marge d’action. En revanche, celles qui s’attaquent à des questions sensibles telles que la corruption, la protection de l’environnement, l’immigration, les droits culturels ou à la communauté amazighe font l’objet de restrictions. Sur le plan juridique, la Rapporteuse spéciale a appelé les autorités algériennes à mettre le code pénal, en conformité avec la résolution du Conseil des droits de l’homme adoptée en 2022 qui appelle les États à s’assurer que les mesures anti-terroristes restent conformes aux obligations internationales et ne portent pas atteinte aux droits et à la sécurité des défenseurs des droits humains. Dans son rapport, la Rapporteuse avait rappelé que l’article 87 bis était l'un des articles du Code pénal les plus souvent cités pour réprimer les défenseurs des droits de l’homme est l’article 87 bis portant sur la répression des actes terroristes. Cette disposition est tellement large et vague qu’elle permet d’arrêter les défenseurs des droits humains dans des proportions considérables. Elle s’est inquiétée de la répression des journalistes et bloggeurs qui critiquent les autorités algériennes via les réseaux sociaux. Elle a terminé son propos en affirmant « être disposée à travailler avec le gouvernement algérien dans un esprit productif et de bonne foi » appelant dans le même temps le gouvernement à mettre la législation nationale en conformité avec les instruments juridiques internationaux.
L’instrumentalisation inquiétante de dispositions pénales pour réprimer les défenseurs des droits humains
Avant d’évoquer la situation des défenseurs des droits humains en Algérie, Zakaria Hannache est revenu sur son expérience personnelle, ayant lui-même été victime d’acharnement judiciaire et vivant désormais en exil. Son travail, pour lequel il a été condamné à trois ans de prison, consistait à documenter les arrestations et poursuites judiciaires dirigées à l’encontre des défenseurs des droits humains, opposants politiques, journalistes et citoyens en Algérie depuis le Hirak. Dans le contexte de la répression qui a suivi le mouvement Hirak, de nombreux défenseurs des droits humains ont été arrêtés, emprisonnés, persécutés ou contraints à l’exil pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression et d’association, pourtant garantis par la Constitution et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Il a illustré ses propos par la dissolution arbitraire de la Ligue algérienne de défense des Droits humains (LADDH) en 2022, rappelant que ce fut l’une des plus anciennes organisations de défense des droits humains en Algérie. Il a également dénoncé la création, par les autorités algériennes, d’une centaine d’association dont la fonction principale consiste à défendre le bilan des autorités en matière de droits humains plutôt qu’à dénoncer des violations. Hannache a cité plusieurs dispositions législatives, qu’il a qualifiées de « liberticides », telles que les articles 95, 96, 99, 87bis, 100, 144bis, 146 et 187bis du Code pénal. Pour illustrer l'impact de ces dispositions, il a évoqué les situations préoccupantes de plusieurs défenseurs, comme Tahar Larbi, défenseur de l’environnement, Kamira Naït Sid, co-présidente du Congrès mondial Amazigh, ou encore celle de l’avocat Mounir Gharbi, membre du Collectif de défense des détenus d’opinion.
Atteintes aux libertés d'information, d'association et au droit de grève
Mouloud Boumghar, professeur de droit public, a fourni une analyse juridique des récentes révisions législatives en Algérie. Son constat est celui d’un grave affaiblissement des libertés fondamentales dans le pays. Il a rappelé que la liberté de la presse est garantie par la Constitution algérienne, mais que sa portée reste limitée par de larges clauses de restriction des droits et libertés, ainsi que par des renvois à la loi qui en fixe les modalités. Il s’est dit particulièrement préoccupé par l’adoption de la loi organique sur l’information en août 2023, et par deux lois sur l’activité audiovisuelle et sur la presse écrite et la presse électronique en décembre de la même année. Selon lui, « ces lois énoncent un nombre important de lignes rouges dans l’exercice de l’activité de presse et le droit à l’information, d’une manière telle qu’elle vide la liberté d’expression et celle de la presse de l’essentiel de leur contenu ». La répression de l’espace civique est également perceptible dans le monde du travail. En 2023, le gouvernement algérien a sévèrement limité le droit de grève. Ainsi, la loi relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève interdit les grèves à motifs politiques, de solidarité, celles pour des causes ou revendications non socio-professionnelles, ainsi que celles déclenchées par des organisations syndicales dont la représentativité n’est pas établie. Le texte instaure par ailleurs un régime d’autorisation préalable avec un contrôle sur le fond des activités. Si la Constitution garantit que la dissolution d’une association ne peut qu’intervenir par une décision de justice, Boumghar relève qu’il est fait une interprétation très large de la loi. Il souligne également que le simple contact entre une association algérienne et une association étrangère suffit à caractériser la coopération, qui nécessite une autorisation préalable, alors que l’absence d’une telle autorisation est susceptible d’entraîner la dissolution de l’association algérienne. Il a conclu que le droit algérien méconnaît la liberté d’association en pratique.
Disparitions, répression et espoir : Nassera Dutour porte la voix des oubliés d’Algérie
Nassera Dutour, présidente du Collectif des Familles de Disparu·e·s en Algérie, a souligné que le préalable à l’exercice d’activités associatives en Algérie devrait être l’État de droit, l’indépendance de la justice, et le respect des libertés fondamentales. En écho à ce qui a été dit par d'autres panélistes, elle a partagé son inquiétude quant à l’adoption de lois visant à réprimer toute voix dissidente, notamment à l’encontre des avocats et des membres de la société civile ayant participé au mouvement du Hirak en 2019. Dutour a également dénoncé le non-respect des garanties procédurales par les autorités algériennes, en faisant état d’absences fréquentes d’avocats lors des comparutions et d’abus sexuels commis durant des arrestations. Elle a notamment évoqué le cas de Mohamed Tadjadit, un jeune poète algérien réprimé et condamné à plusieurs reprises pour avoir participé à des manifestations pacifiques lors du Hirak, et avoir exercé son droit fondamental à la liberté d’expression. Forte de son combat en faveur du droit à la vérité, Dutour a fait le lien entre la répression systématique de la société civile et l’absence de justice pour les victimes des violations commises lors de la décennie noire. Avec beaucoup d’émotion, Dutour a évoqué le sort de son fils, disparu alors qu’il avait à peine 21 ans durant la décennie noire en 1997. Toujours à sa recherche, elle a témoigné de sa douleur face au silence auquel les mères de milliers de disparus sont confrontées depuis tant d’années. Dutour a conclu en réaffirmant sa détermination à se battre pour que les familles connaissent la vérité et obtiennent justice concernant leurs proches arrêtés et disparus, pour la liberté de la jeunesse algérienne, ainsi que pour l’indépendance de la justice en Algérie.
Enfin, ce fut l’occasion, pour des représentants de la société civile tunisienne présents dans la salle de partager les similitudes observées entre l’Algérie et la Tunisie et de réaffirmer leur soutien au peuple algérien.
Pour visionner l'intégralité de la discussion, cliquez ici.