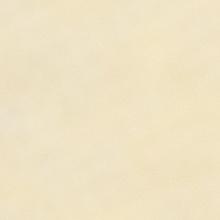September 25, 2025

(Beyrouth, le 25 septembre 2025) – Les autorités algériennes devraient mettre fin au contrôle excessif sur les organisations de la société civile et le Parlement devrait adopter une nouvelle loi sur les associations basée sur les normes internationales relatives aux droits humains, ont déclaré aujourd’hui sept organisations de défense des droits humains. L’avant-projet de loi considéré pour remplacer la loi de 2012 actuellement en vigueur porterait encore plus atteinte au droit à la liberté d’association.
Cet avant-projet, consulté par les organisations, au lieu de corriger les dispositions de la loi actuelle qui violent le droit à la liberté d’association, introduit des restrictions supplémentaires et renforce le contrôle du gouvernement sur les associations dans le pays. Il ne donne pas aux associations la possibilité de se former sans autorisation préalable du gouvernement, comme l’exige la Constitution. Au lieu de le présenter au Parlement, les autorités devraient enterrer le projet de loi, ont déclaré les organisations.
« Les autorités algériennes devraient cesser d’ériger des obstacles qui empêchent les associations de fonctionner librement » », a déclaré Alexis Thiry, conseiller juridique au sein de MENA Rights Group. « Loin de pallier les lacunes de la loi algérienne sur les associations, ce texte empirerait la situation. »
Les organisations de la société civile algérienne subissent une répression et des restrictions grandissantes depuis l’émergence du mouvement de protestation Hirak en 2019. Les autorités ont interdit des rassemblements publics et politiques, ciblé les groupes de défense des droits humains et des défenseurs, et dissous deux associations connues : le Rassemblement actions jeunesse (RAJ) et la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme. La loi de 2012 actuellement en vigueur comprend des dispositions excessivement générales, à la formulation vague, et impose aux associations des procédures d’enregistrement et de fonctionnement très lourdes.
Le projet de loi octroierait au ministère de l’Intérieur une vaste autorité sur la création, le fonctionnement et le financement des associations, ainsi qu’un contrôle quasi illimité de leurs activités. Il n’a pas encore été officiellement présenté au Parlement.
Ce projet de texte impose des restrictions arbitraires en ce qui concerne les objectifs et les activités des associations. Il définit étroitement leur raison d’être comme un « soutien aux autorités publiques [...] afin de mettre en œuvre les politiques publiques », ce qui contredit le principe même de société civile indépendante. Il exige que les associations mènent leurs activités dans le respect de valeurs nationales telles que « l’unité nationale et l’intégrité territoriale » ou « les composantes fondamentales de l’identité nationale », des termes vagues qui pourraient être invoqués pour restreindre arbitrairement le travail d’une association.
Tout comme la loi de 2012, le texte interdit aux organisations d’entretenir « quelque relation que ce soit » avec les partis politiques ou de recevoir une aide financière de leur part. Les financements étrangers devraient faire l’objet d’une autorisation de la part du ministère de l’Intérieur ou du wali (gouverneur) et tout don ou legs à une association nationale de plus de 1 500 000 dinars algériens (environ 11 550 USD) nécessiterait un « certificat de conformité ».
Par ailleurs, le projet de loi conserve des prérequis importants pour créer une association. Il exige de réunir une assemblée générale en présence d’un huissier et de dix fondateurs au minimum, pour les associations communales, ou de 25 membres fondateurs vivant dans au moins un tiers des gouvernorats du pays, pour les associations nationales.
Tous les membres fondateurs devraient être des ressortissants algériens qui n’ont jamais été condamnés au pénal – ce qui éliminerait de nombreux acteurs de la société civile qui ont été condamnés ces dernières années pour avoir exercé leurs droits fondamentaux.
Ces exigences vont à l’encontre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par l’Algérie en 1987, et des Directives sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, qui précisent que « [pas plus] de deux personnes [ne doivent être requises] pour créer une association » sans discrimination, et que « le seul fait que l’individu ait été auparavant l’objet d’une condamnation pénale ne saurait constituer une incapacité en matière de création d’association ».
Le projet de texte impose également un système d’enregistrement fastidieux, similaire à celui de la loi actuelle. Le projet de loi exige que les groupes présentent certains documents que les autorités vérifieront avant d’émettre un récépissé d’enregistrement dans un délai de 30 à 60 jours. Le récépissé doit alors être publié dans au moins un journal dans un délai de 30 jours. Si les autorités n’émettaient pas de récépissé dans le délai imparti, l’association serait considérée comme légalement enregistrée, mais ne pourrait pas mener d’activités. En pratique, de nombreuses organisations de défense des droits humains ont rencontré des difficultés insurmontables pour obtenir un récépissé d’enregistrement.
Les Directives sur la liberté d’association et de réunion en Afrique exigent que « les associations reçoivent séance tenante les documents officiels confirmant leur déclaration ».
Toujours d’après le projet de texte, les autorités pourraient empêcher la création d’une association en se fondant sur une « décision motivée » qui ne pourrait être contestée que devant un tribunal. Afin d’ouvrir un siège, une association nécessiterait d’avertir le gouverneur concerné, qui pourrait s’y opposer pour des motifs d’ordre public ou de sécurité.
Le projet de loi conserverait par ailleurs les restrictions pesant sur les associations étrangères, les empêchant de fonctionner librement et conférant au ministère de l’Intérieur un contrôle important, en contradiction des directives de la Commission africaine. Toute coopération entre des associations algériennes et des associations étrangères serait soumise à des dispositions vagues, telles que le respect des « valeurs et constantes nationales ». La possibilité, pour une organisation internationale, d’établir un siège en Algérie dépendrait des « relations amicales » entre l’Algérie et le pays d’origine de l’organisation. Une association comprenant des membres étrangers nécessiterait « des accords d’amitié ou de coopération entre l’Algérie et les pays des membres fondateurs ». Dans les deux cas, ces associations seraient soumises à l’approbation du ministère de l’Intérieur, révocable à tout moment. Le texte ne précise aucune procédure d’appel pour le cas où le ministère refuserait ou révoquerait son autorisation.
Parmi les autres exigences fastidieuses figurerait l’obligation de fournir aux autorités un compte-rendu, un rapport financier et un rapport moral dans un délai de 30 jours après chaque assemblée générale. Le projet de loi permettrait aussi au ministère de l’Intérieur d’inspecter le siège des associations à tout moment et d’avoir accès aux documents administratifs et comptables. Ce type de dispositions abusives permet une surveillance intrusive, sans contrôle judiciaire, et ouvre la voie à d’autres abus.
Le projet de texte permettrait aux autorités de suspendre une association pendant 30 jours pour divers motifs, notamment le non-renouvellement de ses instances exécutives ou la violation de ses statuts. Un avis officiel serait adressé à l’association ; ce qui constitue un recul par rapport à la loi de 2012, qui exigeait un avis officiel assorti d’un droit de réponse avant la suspension.
Le droit de créer des associations est garanti par l’article 53 de la Constitution algérienne et « s’exerce par simple déclaration ». L’Algérie a l’obligation de respecter, protéger, promouvoir et réaliser le droit à la liberté d’association, tel que défini par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Les limitations de ce droit ne sont permises que lorsqu’elles sont prescrites par la loi et nécessaires dans une société démocratique – c’est-à-dire lorsqu’elles emploient les moyens les moins restrictifs possibles et qu’elles correspondent aux valeurs fondamentales que sont le pluralisme et la tolérance. es restrictions « nécessaires » doivent aussi être proportionnées et non discriminatoires, notamment vis-à-vis de la nationalité, des opinions politiques ou des croyances.
« Les autorités algériennes devraient saisir cette opportunité pour introduire une nouvelle loi qui réponde aux normes internationales sur le droit à la liberté d’association et permette aux groupes de la société civile de fonctionner librement, sans restrictions injustifiées ni crainte des représailles », a conclu Bassam Khawaja, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Le récent projet de loi sur les associations devrait être entièrement revu, en consultant la société civile, pour en retirer les dispositions restrictives. »
Organisations signataires :
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
EuroMed Rights
Comité de sauvegarde de la Ligue algérienne pour la défense des droits humains (CS-LADDH)
Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), dans le cadre de l’Observatoire pour la protection des défenseur·e·s des droits humains
Fondation pour la promotion des droits
Human Rights Watch
MENA Rights Group
Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans le cadre de l’Observatoire pour la protection des défenseur·e·s des droits humains