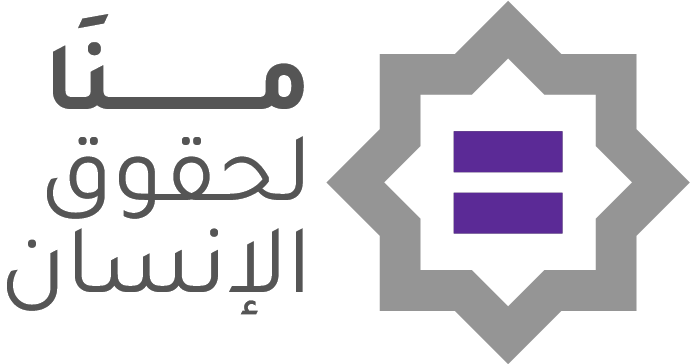Etat des lieux des droits civils et politiques en Mauritanie
Le présent rapport analyse la mise en œuvre en droit et en pratique par la Mauritanie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié le 17 novembre 2004 à la lumière des informations fournies par l’État partie dans son premier rapport périodique daté du 22 novembre 2017, de la liste des points fournie par le Comité des droits de l’homme s’y référant et des réponses fournies par l’État partie datées du 18 avril 2019[1].
Le présent rapport a bénéficié de l’expertise de l’Assistance aux femmes et enfants en difficulté et a été endossé par l’Association des Haratines de Mauritanie en Europe.
La période d’analyse couvre la période entre le 20 novembre 2013, date des dernières observations finales du Comité[2], et mai 2019.
2. Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (Article 2 ; points numéro 1 et 2)
2.1 Cadre constitutionnel et juridique
Le système juridique mauritanien est de type moniste avec une primauté des traités internationaux sur les lois nationales. Cependant, l’État partie inverse régulièrement la hiérarchie des normes notamment dans le cadre de sa collaboration avec Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH)[3]. Dans la réponse de la Mauritanie à la liste des points, l’État partie défend la primauté de la Constitution, dont la Charia est l’unique source de loi, sur les instruments juridiques ratifiés[4].
Les dispositions du Pacte sont théoriquement d’application directe au sein de l’État partie. Elles peuvent être invoquées devant les tribunaux et prévalent sur la loi nationale. Cependant, les exemples dans la pratique sont rares, voire inexistants. L’État partie affirme avoir publié les principaux traités relatifs aux droits de l'homme dans le journal officiel en 2014 et avoir réalisé plusieurs formations afin de faire connaître ces instruments auprès des différents acteurs sans en préciser ni le nombre ni les dates. Le rapport étatique ne mentionne aucune affaire dans laquelle les dispositions du Pacte auraient été invoquées devant les tribunaux grâce à ces mesures de sensibilisation. Seule la réponse à la liste des points fait référence à des affaires dans lesquelles les tribunaux auraient invoqué l’article 11 du Pacte[5].
L’État partie affirme dans ses réponses à la liste des points que le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux « étudie les plaintes qui lui sont soumises par les citoyens, et peut saisir directement les administrations et les secteurs concernés et contribue à la résolution des conflits entre les citoyens et les collectivités[6]. »
Le Haut Conseil est une institution créée en 2012 par le décret n°2012-134. Il s’agit de la seule autorité de régulation du lancement des fatwas et de résolution des différends connexes entre les citoyens et les organismes publics. L’institution manque néanmoins d’indépendance dans la mesure où ses membres sont tous nommés par décret présidentiel[7]. L’État partie ne précise pas si les justiciables mauritaniens, en cas de violation, peuvent invoquer l’ensemble des dispositions du Pacte devant le Haut Conseil. Cette même institution avait notamment appelé les autorités à donner au blogueur Mohamed Ould Mkheitir, la « punition qui s’impose » (voir section 4 infra : droit à la vie)[8].
2.2 Rétrogradation de la Commission nationale des droits de l’homme
Dans son rapport, l’État partie affirme que la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a été accréditée au statut A des institutions nationales des droits de l’homme[9]. Le Sous-comité d’accréditation (SCA) de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a pourtant recommandé en octobre 2018 de rétrograder la Commission au statut B[10], constatant l’absence de progrès réalisé depuis l’adoption d’un précédent rapport en novembre 2017. Le SCA a invoqué le manque de transparence du processus de sélection des membres de la CNDH ainsi que son manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Le 5 juillet 2017, les autorités mauritaniennes avaient adopté la loi n°2017-016 fixant la composition, l’organisation, et le fonctionnement de la CNDH remplaçant la loi n°2010-031 suite aux conclusions du SCA dans un rapport antérieur daté de novembre 2016 décrivant le processus de sélection et de désignation comme n’étant pas suffisamment « ample et transparent ».
Dans son rapport de novembre 2017, le SCA a estimé que « les nouvelles dispositions de la loi répondaient bien à une partie des préoccupations soulevées en novembre 2016, mais qu’elles ne suffisaient pas à répondre au fond des préoccupations précédemment mentionnées, à propos de l'indépendance du processus de sélection et de nomination »[11]. Dans son rapport de 2018, le SCA ajoute que « la CNDH n’a pas répondu de manière adéquate au fond de ses préoccupations concernant l’indépendance réelle ou perçue des candidats choisis par les différentes entités »[12].
En outre, le SCA a relevé avec préoccupation une « réticence à s'impliquer effectivement dans les affaires concernant de graves violations des droits de l’homme, qui vont depuis des allégations de torture jusqu’aux conditions de détention, aux détentions arbitraires ou à la liberté d'expression »[13].
En effet, la CNDH souffre d’un déficit de confiance au sein de la société civile particulièrement au sein des organisations travaillant sur les questions dites « sensibles », telles que les droits des Harratines, la torture et autres violations et crimes du passé.
La CNDH est habilitée à recevoir des plaintes individuelles. À la question du Comité sur le nombre précis de plaintes déposées et enregistrées pour actes de torture[14], l’État partie a répondu que la CNDH avait « reçu et traité 695 plaintes relatives aux droits socioéconomiques et aux droits fonciers »[15]. L’incapacité de la CNDH à traiter toutes les violations des droits humains sans discrimination démontre le manque d’autonomie et d’indépendance de l’institution.
En outre, le SCA a rappelé que « les mesures que la CNDH aurait ou n’aurait pas dû prendre et les déclarations qu’elle aurait ou n’aurait pas dû faire portent atteinte à la crédibilité de l’institution auprès des membres de la société civile, en particulier les organisations se montrant critiques »[16].
Non seulement la CNDH s’abstient de prendre position dans des affaires relevant de son mandat, mais elle tend à aligner ses prises de position avec celles du gouvernement de l’État partie. À la suite de la fermeture de cinq chaînes de télévision en 2017, la CNDH a estimé dans une déclaration publique que les motifs de la fermeture étaient liés au non-respect des engagements financiers pris par ces chaînes en vers la société de diffusion de Mauritanie (SDM), l’autorité de régulation de la diffusion en Mauritanie[17]. L’ONG Reporters sans frontières parle de son côté de pressions financières exercées par les autorités pour limiter les voix critiques (Voir section 7.1 infra : libertés d’opinion et d’expression)[18].
En outre, la CNDH s’est prononcée en faveur de l’application de la peine de mort dans l’affaire de Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir accusé de « crime d’apostasie contre l’islam et son prophète ». En effet, la Commission, à travers un communiqué de sa présidente, Irabiha Abdel Wedoud, avait en effet affirmé que : « [b]lasphématoires, vexatoires et provocateurs, ces écrits hérétiques ont été confirmés par leur auteur qui a persisté dans sa diatribe contre l'islam et son Prophète. Ce faisant, il entre dans le champ d’application de l’article 306 de l’Ordonnance n°83-162 du 9 juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal »[19].
La proximité entre Mme Wedoud et le président actuel, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, nuit également à la neutralité de l’institution. Alors qu’elle n’était pas encore présidente de la CNDH, elle a publiquement salué le coup d’État mené, entre autres, par Mohamed Ould Abdel Aziz à la suite duquel le président élu démocratiquement Sidi Ould Cheikh Abdallahi a été déposé[20].
Enfin, le SCA s’est déclaré préoccupé par l’écart entre la contribution de la CNDH à l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, selon lequel il n’y aurait aucun cas de détention arbitraire et les informations crédibles qu’il a reçues faisant état d’une telle pratique[21].
En vertu de ce qui précède, le Bureau de l'Alliance Globale des institutions nationales des droits de l'homme a décidé d'approuver les recommandations du SCA faites en octobre 2018 relatives à la CNDH, à la fois en ce qui concerne le statut de l'accréditation et les recommandations.
2.3 Rôle joué par le Mécanisme national de prévention
Suite à la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT), la Mauritanie a promulgué la loi n°2015-034 instituant un Mécanisme national de prévention (MNP). Celui-ci est chargé « d’effectuer des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention, de recevoir des plaintes et allégations de torture, de rendre des avis concernant le texte de projets de lois et de règlements relatifs à la prévention de la torture, de formuler des recommandations afin de prévenir la torture, de mener des campagnes de sensibilisation, d’organiser des programmes de formation, de réaliser et de publier des recherches, études et rapports relatifs à son domaine de compétence, et de coopérer avec la société civile et les institutions de lutte contre la torture»[22].
Le Sous-Comité pour la prévention de la torture a effectué une visite en Mauritanie en octobre 2016 afin de « fournir des conseils et une assistance technique» au MNP[23]. L’État partie a accepté que le rapport confidentiel établi par le Sous-Comité soit rendu public. Dans son rapport, ce dernier note certaines lacunes d’ordre normatif pouvant remettre en cause l’indépendance du MNP vis-à-vis du pouvoir exécutif. En effet, l’article 11 de la loi habilitante prévoit que le président du MNP est nommé par décret présidentiel. Le secrétaire général de l’institution est quant à lui nommé par décret adopté en Conseil des ministres. Un tel processus de nomination porte préjudice à l’indépendance du Mécanisme[24].
Par ailleurs, le Sous-Comité a également noté des incertitudes concernant les attributions de l’institution, en particulier « quant à la coordination de ses activités et prérogatives avec les autres partie prenantes »[25]. En effet, le mécanisme de visite du MNP est comparable à celui prévu au titre de l’article 4 de la loi n° 2017-016 fixant la composition, l’organisation, et le fonctionnement de la CNDH. La répartition des tâches entre ces deux organismes n’a toujours pas été clarifiée par l’État partie. Si le MNP a été en mesure de réaliser sa première visite lors de la visite du Sous-Comité, laquelle a été suivie d’autres visites de lieux privatifs de liberté, le Sous-Comité a recommandé à l’État partie d’entreprendre des visites inopinées et de maintenir confidentiel le programme de ses visites[26]. Le rapport de l’État partie ne précise pas le nombre de visites inopinées effectuées depuis la création du MNP.
En vertu de l’article 3 de la loi n°2015-034, le MNP est habilité à recevoir des plaintes individuelles. L’État indique que des boîtes aux lettres ont été installées afin d’accueillir les correspondances qui lui sont adressées[27]. L’État partie ne précise pas combien de plaintes ont été transmises au MNP à travers ce mécanisme.
L’État partie affirme que le MNP a le droit d’accès à tous les lieux de privation de liberté. Or, le 10 juillet 2016, l’un des membres du MNP, M. Boubacar Ould Messaoud, s’est vu refuser une demande de visite adressée à la Direction régionale de la sûreté de Nouakchott Ouest et le commissariat de police Ksar I. Ce dernier voulait alors rencontrer des activistes de l’IRA-Mauritanie qui avaient été arrêtés le 30 juin 2016 à la suite des évènements qui ont eu lieu lors de l’opération d’expulsion de la Gazra de Bouamatou le 29 juin 2016[28]. Sa demande de visite a été rejetée bien que ce dernier se soit adressé au procureur de la République de Nouakchott Ouest ainsi qu’au procureur Général près la Cour suprême.
Dans une déclaration[29], M. Boubacar Ould Messaoud a dénoncé l’absence de respect de l’article 3 de la loi n°2015-034 qui l’autorise « à effectuer des visites régulières, programmées ou inopinées, sans aucun préavis et à tout moment dans tous les lieux où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté ».
Recommendations:
- Remédier au manque de conformité de la CNDH avec les Principes de Paris relevée dans le rapport du SCA ;
- Mettre en œuvre les recommandations du Sous-Comité pour la prévention de la torture formulées dans son rapport de visite.
3. Lutte contre l’impunité (articles 2, 6, 7 et 14 ; points numéros 3)
Du milieu des années 1980 au début des années 1990, le gouvernement, alors dirigé par le colonel Maaouya ould Sid'Ahmed Taya, a expulsé un nombre estimé à 60 000 Mauritaniens issus des communautés Halpulaars, de Soninkés et de Wolofs désignés sous le terme générique d’ « Afro-mauritaniens », dans un contexte de tensions à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal[30]. Les expulsions ont été accompagnées de graves violations des droits humains.
Entre octobre 1990 et mi-janvier 1991, les autorités ont arrêté arbitrairement environ 3 000 Afro-Mauritaniens dont la plupart étaient des militaires. Selon les estimations, entre 500 et 600 d’entre eux ont été victimes d’exécutions sommaires précédées de torture et de détention au secret[31].
Afin de traiter ces violations, communément qualifiées en Mauritanie de « passif humanitaire », les autorités ont promulgué la loi n°93-23. Celle-ci accorde l’amnistie aux membres des forces de sécurité pour toutes les infractions qu’ils auraient pu commettre dans le cadre de l’exercice de leur fonction durant la période allant du 1er janvier 1989 au 18 avril 1992[32].
De manière générale, le Comité des droits de l’Homme a estimé que les lois d’amnistie étaient « généralement incompatibles avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels actes, de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas à l’avenir. Les États ne peuvent priver les particuliers du droit à un recours utile y compris le droit à une indemnisation et à la réadaptation la plus complète possible »[33].
En l’espèce, la loi n°93-23 inscrit dans le cadre législatif de l’État partie une impossibilité légale d’introduire un recours effectif en violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte lu conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 2. En effet, l’article 2 de la loi n° 93-23 stipule que « toute plainte, tout procès-verbal et tout document d’enquête relatifs à cette période […] sera classée sans suite. »
Le deuxième rapport périodique indique qu’une commission nationale de recensement des agents et fonctionnaires victimes des évènements de 1989 a été mise en place. L’État partie affirme que 1159 fonctionnaires ont obtenu leurs droits conformément aux solutions proposées par la commission[34]. Il s’agit de mesures de réparation qui se sont traduites par « l’indemnisation des ayants droit (Diya) et par le devoir de mémoire ». Sur ce deuxième point, l’État rappelle qu’il a eu l’occasion de reconnaître sa responsabilité, notamment à l’occasion d’une prière collective organisée à Kaédi le 25 mars 2009[35]. Ainsi, l’État partie estime avoir abouti au règlement du passif humanitaire à travers ces mesures.
Cependant, les autorités ne sauraient opposer les mesures d’indemnisation et de reconnaissance au droit à un recours utile des victimes et de leurs familles. De plus, à l’occasion de l’examen de la Mauritanie par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), ce dernier a noté l’absence d’une solution visant à faire la lumière sur ces évènements. Le CERD a ainsi recommandé à l’État partie d’abroger la loi d’amnistie de 1993 afin d’établir la vérité et les responsabilités sur ces évènements et de pourvoir à une réparation adéquate de toutes les victimes et leurs ayants droit[36].
De son côté, le Comité contre la torture s’est déclaré préoccupé par l’absence de volonté politique de la part de l’État partie d’amender la loi d’amnistie n°92-93. Dans ses réponses à la liste des points, l’État partie a réitéré son intention de ne pas abroger la loi, celle-ci traduisant « la volonté des représentants du peuple mauritanien. »
À cette absence d’enquête indépendante et de processus permettant de faire la lumière sur ces violations, s’ajoute une pratique inquiétante de représailles contre les victimes, leurs ayants droit et activistes dénonçant l’impunité et revendiquant des enquêtes impartiales et la poursuite des auteurs des violations[37]. En effet, les activités de COVIRE et du Collectif des veuves des victimes militaires et civiles des événements de 1989-1991 sont régulièrement entravées lorsque ces organisations tentent de commémorer les massacres, les exécutions et les disparitions forcées commis durant cette période, les autorités leur refusant les permissions requises pour organiser des réunions ou dispersant leurs réunions pacifiques. En outre, certaines victimes ou leurs ayants droit qui refusent les mesures d’indemnisations prévues aux titres de la loi et de l’accord-cadre du fait de leurs insuffisances, se heurtent à l’impossibilité d’une action judiciaire civile en réparation.
Recommendations:
- Mettre fin aux mesures de représailles contre les ayants droit des victimes de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire commis durant le « passif humanitaire » ;
- Abroger la loi n°93-24 afin de garantir aux victimes et à leurs ayants droit leur droit à un recours effectif.
4. Droit à la vie (article 6 ; points numéro 11 à 15)
L’État partie rappelle dans son rapport qu’un moratoire de fait sur l’exécution de la peine de mort est observé depuis 1987. Dans ses Observations générales n° 36, le Comité des droits de l’homme prévoit un certain nombre de conditions concernant l’application de la peine de mort dans les pays, qui n’ont pas aboli la peine de mort et qui n’ont pas ratifié le deuxième Protocole facultatif, à savoir que celle-ci doit être prévue uniquement pour les crimes les plus graves. En outre, elle ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent à l’issue d’une procédure offrant toutes les garanties possibles d’un procès équitable. Enfin, tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine[38].
Le Comité précise que « les crimes les plus graves doit être compris de manière restrictive et s’étendre uniquement aux crimes d’une extrême gravité, impliquant un homicide intentionnel[39]. » En outre, « les peines de mort obligatoires qui ne laissent aux juridictions nationales aucune latitude s’agissant de qualifier ou non l’infraction de crime passible de la peine de mort et de prononcer ou non la peine capitale dans la situation particulière de l’auteur de l’infraction, sont arbitraires par nature »[40].
L’État partie affirme qu’en droit mauritanien la peine capitale est réservée aux crimes les plus graves[41]. Or, le Code pénal mauritanien prévoit la peine de mort pour viol, brigandage et incendie criminel[42], y compris en l’absence d’homicide volontaire. La peine de mort est également prévue pour d’autres crimes qui ne peuvent entrer dans la catégorie des crimes les plus graves comme l’adultère lorsque le coupable est marié ou divorcé[43], l’apostasie[44], les relations entre personnes du même sexe[45], la trahison[46], et l’espionnage[47]. L’État partie affirme que « [l]es propos blasphématoires et les sacrilèges contre l’image d’Allah, tous ses prophètes et ses livres saints constituent aux termes des principes immuables de l’État et de l’opinion publique nationale, des actes d’extrême gravité, justifiant la sanction prévue, conforme à son système juridique et son opinion nationale[48].»
Dans ses réponses à la liste des points, l’État partie affirme que « [t]out condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine peuvent être accordées, dans les conditions fixées par la loi »[49]. Le 27 avril 2018, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi imposant la peine capitale pour tout acte blasphématoire, même en cas de repentir. La nouvelle loi supprime ainsi la possibilité, prévue par l’article 306 du Code pénal, de remplacer la peine capitale par une peine d’emprisonnement pour certaines infractions liées à l’apostasie lorsque l’auteur se repent immédiatement. En outre, elle étend le champ d’application de la peine de mort aux « actes de rébellion »[50].
Non seulement l’apostasie ne saurait entrer dans la catégorie des crimes les plus graves, mais l’imposition obligatoire de la peine de mort contrevient à l’obligation sus-citée de l’État de respecter le droit de recourir à une instance supérieure, les droits de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
Cette réforme est liée aux poursuites à l’encontre du blogueur Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir. Le 24 décembre 2014, ce dernier avait été condamné par le tribunal de première instance de Nouadhibou pour « apostasie » sur la base l’article 306, et ce en relation avec des publications en ligne dénonçant l’usage de la religion pour légitimer les pratiques discriminatoires dont est victime la communauté dite des forgerons à laquelle il s’identifie. En avril 2017, le Groupe de travail sur la détention arbitraire avait adopté une opinion demandant sa libération immédiate et affirmant son droit à demander réparation[51].
Le 9 novembre 2017, la cour d’appel de Nouadhibou a réduit sa peine à deux ans d’emprisonnement assorti d’une amende, après avoir reconnu qu’il s’était repenti. Il convient de rappeler ici le caractère inacceptable des interdictions servant à empêcher ou à réprimer la critique des dirigeants religieux ou le commentaire de la doctrine religieuse et des dogmes d’une foi[52].
Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir aurait dû être remis en liberté étant donné le fait qu’il avait passé près de trois ans en détention au moment où la cour d’appel a commué sa peine. Toutefois, il est actuellement toujours détenu au secret. Le 2 mai 2018, les autorités mauritaniennes ont informé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) qu’il était « en détention administrative pour sa propre sécurité ». Lors de l’examen du deuxième rapport périodique devant le Comité contre la torture, la délégation de la Mauritanie a expliqué que cette mesure serait levée « dès que le maintien de l’ordre public et la sécurité physique de l’intéressé seront garantis »[53]. Contrairement aux affirmations de l’État partie selon lesquelles « il n’existe aucune allégation de disparition forcée »[54], les proches de Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir ainsi que ses avocats et la société civile mauritanienne sont maintenus dans l’ignorance concernant son sort et l’endroit où il est actuellement détenu. Le 8 mai 2018, un groupe d’experts onusien a dénoncé son maintien en détention et a demandé sa libération immédiate[55].
Enfin, la loi n°2010-035 relative à la lutte contre le terrorisme a considérablement étendu le nombre des infractions passible de la peine de mort. Celle-ci prévoit que tout acte terroriste est passible de la peine de mort s'il provoque la mort d'une ou plusieurs personnes[56]. Le texte comprend une définition excessivement large des infractions terroristes (voir section 6.3 infra )[57].
Recommendations:
- Accéder au second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort ;
- À défaut d’une abolition « de jure » de la peine de mort, veiller à ce que celle-ci ne soit prononcée que pour les « crimes les plus graves » au terme d’un procès équitable en garantissant le droit de recourir à une instance supérieure, de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
5. Interdiction de la torture (article 7 ; points 16 à 18)
5.1 Criminalisation de la torture
À la suite de l’examen du rapport initial de la Mauritanie, l’État partie était appelé à adopter une définition de la torture et incriminer clairement la torture dans le Code pénal en conformité avec l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les normes internationales pertinentes[58].
L’État partie a adopté la loi n°2015-033 relative à la lutte contre la torture qui définit la torture dans son article 2 de la manière suivante :
« Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des enseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. »
Cette définition est conforme à l’article 1 de la Convention contre la torture. Par ailleurs, la loi consacre l’interdiction absolue de la torture dans son article 14, lequel prévoit que :
« [a]ucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre, de l’état d’urgence ou de toute autre situation d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
La torture ne peut être justifiée par l’ordre du supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique. »
L’article 15 ajoute que :
« Nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre un acte équivalent à la torture ou aux peines ou traitements cruels inhumains et dégradants. »
Toutefois, l’approche de l’État partie du droit applicable aux actes qualifiés de « terroristes » ou d’atteinte à la sécurité de l’État contredit l’article 14 de la loi et le caractère impératif de l’interdiction de la torture.
5.2 Pratique de la torture et mauvais traitements
Suite à sa visite de la Mauritanie en 2016, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a estimé que même si la torture n’est pas généralisée, elle reste fréquente[59].
La situation a peu évolué depuis. Des rapports crédibles font état d’actes de torture et de coups et sévices infligés dans des centres de détention de la police, dans plusieurs prisons du pays ainsi que dans des installations militaires et des postes de la gendarmerie[60]. Les actes de torture sont principalement commis lors de l’arrestation et au début de la détention dans le but de punir et/ou d’extorquer des aveux ou afin d’obtenir des informations permettant d’identifier d’autres suspects. Les services de police et de gendarmerie n’ont pas les capacités nécessaires pour mener des enquêtes sérieuses, reposant sur des techniques d’interrogatoire non coercitives, éthiques et fondées sur la connaissance des faits[61].
Le Rapporteur spécial a ainsi estimé que la torture demeurait aussi bien pratiquée à l’encontre des personnes soupçonnées d’infractions mineures que pour celles soupçonnées de crimes graves. Les personnes soupçonnées de terrorisme ou de menaces contre la sécurité nationale sont quant à elles particulièrement exposées au risque de subir des tortures et des mauvais traitements durant les premières heures qui suivent leur arrestation et pendant leur détention[62].
L’État partie juge ces informations infondées au motif que cette pratique est interdite par la loi[63].
Concernant la question de l’irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture et l’obligation d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements, le Rapporteur spécial contre la torture avait noté « un manque de volonté général au sein de l’appareil judiciaire d’enquêter sur les personnes soupçonnées d’actes de torture et de mauvais traitements et de les poursuivre[64]. » Cette conclusion a été corroborée par le Comité contre la torture, lequel a également souligné « le manque d’expertise médico-légale pour prouver ces allégations, étant donné qu’il n’existe qu’un médecin légiste dans le pays[65]. »
Dans ses réponses à la liste des points, l’État partie fait référence à l’affaire n° RP0101/2016 : « malgré que le recours à la torture n’était pas avéré, les preuves et déclarations en jeu ont été écartées par le juge. » L’État ne précise pas comment il s’est acquitté de son obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale[66]. L’État partie ne précise pas si un examen médico-légal a été effectué par exemple.
5.3 Châtiments corporels
L’article 1er de la Convention contre la torture prévoit que la torture « ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
Toutefois, cette clause ne peut pas être utilisée pour justifier le recours à des châtiments corporels en vertu du droit interne. Il a été fermement établi que les châtiments corporels sont interdits en vertu du droit international et de la Convention en particulier. Le Code pénal comprend des peines afflictives et infamantes qualifiées de mauvais traitements ou d’actes de torture par le Comité[67], notamment l’amputation et la flagellation ou encore les travaux forcés à perpétuité. Ces peines sont prévues aux articles 307, 308, 309, 310, 319, 320, 322, 341, 351 du Code pénal notamment en matière d’actes tombant sous les « qissas » (peines soumises à la loi du talion) ou « huddud » (peines appliquées aux violations de certains interdits religieux incluant le meurtre et l’adultère).
En dépit du moratoire sur l'application des châtiments corporels, ces dispositions portent également préjudice aux victimes de harcèlement sexuel ou de viol qui se retrouvent accusées d’adultère et condamnées à des châtiments corporels sur la base de ce chef d’accusation[68].
5.4 Conditions de détention (point numéro 19)
Les conditions de détention demeurent particulièrement préoccupantes au sein des 18 centres de détention que compte le pays.
Dans ses réponses à la liste des points, l’État partie avance le chiffre 2550 personnes privées de liberté pour une capacité théorique de 3174 places[69]. En revanche, il reconnaît dans son rapport que les taux d’occupation des prisons de Dar-Naim et la centrale à Nouakchott atteignent respectivement 182% et 142%[70]. Les derniers chiffres fournis par l’État parti font état d’un taux d’occupation de 241% à Dar-Naim et 83% au sein de la centrale. Toutefois, la surpopulation carcérale ne se limite pas aux prisons de la capitale. La Direction des affaires pénales et de l’administration pénitentiaire a comptabilisé au total sept centres de détention affectés par le surpeuplement en avril 2018[71]. Par exemple, la prison de Sélibaby connaissait un taux d’occupation de 192% en avril 2019[72].
Comme l’affirme l’État partie dans son rapport[73], les autorités ont tenté de résoudre le problème de la surpopulation carcérale qui touche principalement les prisons de Nouakchott en transférant les détenus de la capitale vers d’autres prisons offrant plus de places, comme Aleg, Nouadhibou et Birmougrein.
Ces mesures sont problématiques dans la mesure où les prisons d’Aleg et Birmougrein se trouvent dans le désert et demeurent inaccessibles aux familles de détenus en raison de la distance et des difficultés de transport, privant de facto les détenus de visites familiales. Cela constitue en soi une forme de traitement inhumain pour les détenus et leurs familles. L’État partie ne semble pas vouloir remédier à cette pratique.
L’État n’a en revanche indiqué aucune mesure qui répondrait aux causes structurelles de la surpopulation carcérale[74]. Le taux de détention préventive demeure très élevé dans les prisons en particulier à Nouakchott où il avoisine 60%. Les mesures alternatives à la détention et aux peines sont rares. L’État partie indique que 272 détenus auraient bénéficié de la grâce présidentielle et la libération conditionnelle depuis 2016, sans préciser le ratio entre les deux types de remises en liberté[75].
Aux problèmes de surpopulation carcérale s’ajoute la question de la prise en charge des détenus au sein des établissements carcéraux. L’État partie affirme avoir pris des mesures afin d’améliorer les conditions de détention et de traitement depuis l’examen du rapport initial de la Mauritanie[76]. Néanmoins, l’État partie reste vague quant au chiffrage et à la datation de ces mesures dont la portée est également sujette à caution[77]. En effet, le Comité contre la torture a relevé que les prisons mauritaniennes « souffrent de nombreuses défaillances »[78]. Selon le Mécanisme national de prévention de la torture, 11 centres sont des maisons d’habitation transformées en prisons et souffrent de nombreuses défaillances au niveau de l’assainissement, de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène[79].
L’État partie affirme que la prison des femmes de Nouakchott a été acquise et réhabilitée en 2016 et que les femmes sont incarcérées dans des établissements spécifiques[80]. Toutefois, MENA Rights Group a reçu des informations selon lesquelles l’établissement serait dans un état critique et ne correspondrait pas aux normes internationales. La sécurité serait assurée par un personnel essentiellement masculin. Nous avons également reçu des allégations au sujet d’abus commis par des gardiens de prison sur des détenues[81].
D’autre part, le principe de séparation des détenus mineurs et majeurs n’est pas systématiquement respecté en violation de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant dont la Mauritanie est partie, comme a récemment pu le constater le Comité des droits de l'enfant[82].
L’État n’a toujours pas achevé la construction du « Centre fermé pour enfants en conflit avec la loi » à Nouakchott-Ouest censé mettre un terme au problème. En 2017, les mineurs de la prison centrale de Nouakchott ont été en contact avec des prisonniers adultes, y compris ceux qui avaient été condamnés pour des infractions liées au terrorisme et d’autres crimes violents[83].
Recommendations:
- Mettre en œuvre la loi contre la torture de 2015, de manière à assurer sa primauté sur la loi antiterroriste ;
- S’acquitter de manière effective de l’obligation d’enquêter sérieusement sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements et d’engager de véritables poursuites à leur encontre ;
- Supprimer les châtiments corporels dans l'éventail des peines prévues par les articles 307, 308, 309, 310, 319, 320, 322, 341, 351 du Code pénal équivalents à des actes de torture ;
- Améliorer l’infrastructure des prisons, en veillant à ce que les conditions d’hygiène et de salubrité, la prise en charge alimentaire et l’accès à l’eau potable soient adéquats.
6. Liberté et sécurité de la personne (articles 9 et 14 ; points numéros 20 et 21)
6.1 Garanties fondamentales, droit à la liberté et à la sécurité
Si l’article 4 de la loi relative à la lutte contre la torture n°2015-033[84] consacre un certain nombre de garanties fondamentales dès l’instant où intervient la privation de liberté et bien qu’elles répondent aux recommandations formulées à l’État partie à la suite de l’examen du rapport initial de la Mauritanie[85], les dispositions figurant au titre de l’article 4 ne sont que rarement appliquées notamment en raison de régimes juridiques parallèles appliqués comme lex specialis.
Le Comité contre la torture a estimé en effet que les « dispositions relatives au régime de la garde à vue du Code de procédure pénale, et des lois relatives au terrorisme, à la corruption et aux stupéfiants sont appliquées prioritairement par le juge national »[86].
Bien que le droit à l’accès à un avocat soit garanti dès le moment de l’arrestation selon les termes de l’article 4 de la loi n°2015-033, l’article 58 du Code de procédure pénale prévoit néanmoins que l’accès à un avocat n’est possible qu’après la première prolongation de la durée initiale de la garde à vue et après l’accord du procureur, c’est-à-dire au bout de 48 heures pour les personnes inculpées d’infractions de droit commun et de 72 heures pour les personnes inculpées d’infractions liées aux stupéfiants[87]. L’accès à un avocat n’est accordé que sur autorisation écrite du procureur compétent, pendant une demi-heure maximum et sous la surveillance de la police judiciaire[88]. Pour les besoins de l’enquête, le procureur peut suspendre l’accès à un conseil.
À noter que le délai de garde à vue est calculé sans tenir compte des jours non ouvrables comme le prévoit l’article 56 du Code de procédure pénale, si bien qu’il dépasse fréquemment les 48 heures[89]. En outre, ce sont souvent les officiers de police judiciaire qui décident unilatéralement de prolonger la garde à vue, profitant du fait que les magistrats contrôlent peu les registres et mains courantes[90].
Concernant l’incrimination de la disparition forcée, l’article 13 de la loi n°2015-033 stipule que « [t]out agent de la fonction publique qui détient une personne arrêtée ou condamnée dans un établissement ou dans un lieu non enregistré comme lieu de privation de liberté sera puni d'une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans. » MENA Rights Group regrette néanmoins le fait que la législation de l’État partie n’érige pas encore la disparition forcée en infraction autonome. Le Code pénal ne contient pas à ce jour ni définition ni incrimination de la disparition forcée comme le requièrent les articles 2 et 4 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
6.2 Absence d’application des garanties fondamentales existantes
Le Rapporteur spécial sur la torture avait soulevé qu’au moment de sa visite, les procureurs, les magistrats et les policiers semblaient continuer d’appliquer les anciennes dispositions, soit par ignorance de la loi n°2015-033, soit en raison d’idées fausses sur son application[91]. Ceci est d’autant plus préoccupant que la torture et les mauvais traitements ont lieu en particulier au cours de l’arrestation et au début de la détention[92].
De même, l’obligation d’enregistrer tous les détenus n’est pas respectée, car les registres de détention dans les postes de police et les centres de détention sont souvent mal tenus ou complétés a posteriori[93].
Il n’est pas rare que les forces de l’ordre ne respectent que partiellement ou aucune des garanties énumérées l’article 4 de la loi n°2015-033. Les victimes sont ainsi arrêtées sans mandat, détenues au secret pendant plusieurs jours et soumises à des mauvais traitements.
À titre d’exemple, le sénateur Mohamed Ould Ghadde a été arrêté sans mandat d’arrêt le 10 août 2017. Ce dernier rapporte avoir été détenu au secret pendant une semaine dans une salle du siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Nouakchott. Durant cette période, il n’a pas été autorisé à communiquer avec sa famille ou ses avocats ni à les rencontrer. Ce n’est que le 18 août 2017 que les autorités ont formellement placé M. Ghadde en garde à vue. Ce dernier a été présenté à un juge que le 31 août 2017. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire (GTDA) a reconnu que M. Ghadde avait été « détenu secrètement et au-delà des délais requis avant d’être présenté au juge, en violation de l’article 9 (par. 3) du Pacte »[94].
6.3 Mise en place d’un régime dérogatoire pour les actes qualifiés de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État
Le paragraphe 3 de l’article 9 du PIDCP dispose que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Le Comité estime que si le sens exact à donner à l’expression « dans le plus court délai » peut varier selon les circonstances objectives[95], le laps de temps ne devrait pas dépasser quelques jours à partir du moment de l’arrestation[96].
Le paragraphe 4 de l’article 4 de la loi n°2015-033 consacre « le droit d’être présentée sans délai à un juge » sans toutefois clairement définir la durée maximale de garde à vue. De plus, la législation de l’État partie comporte des dispositions qui ne sont pas conformes aux standards du Comité. L’article 23 de la loi n° 2010-035 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit ainsi la possibilité, en matière de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État, de détenir une personne en garde à vue pour une durée de 45 jours – à savoir 15 jours renouvelables deux fois – sans être présentée à un juge et sans possibilité de contester la légalité de sa détention. Cette disposition constitue également une dérogation au Code de procédure pénale, lequel prévoit en son article 57 que la durée de la garde à vue est de 48 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République. En outre, les personnes détenues pour des crimes prévus dans la loi n° 2010-035 peuvent être placées en garde à vue sans avoir accès à un conseil[97].
Selon les principes de lex posterior derogat legi priori, la loi n°2015-033 annule et remplace les dispositions visées du Code de procédure pénale et de la loi contre le terrorisme. Toutefois, l’État partie n’énonce pas explicitement dans son rapport s’il entend réviser les dispositions qui sont en conflit avec la loi n°2015-033 relative à la torture et les normes internationales en matière de garanties fondamentales. Le ministère de la Justice a antérieurement annoncé que la loi relative à la lutte contre la torture ne s’appliquait pas aux personnes accusées de terrorisme[98]. L’État partie semble vouloir maintenir ce double standard lorsqu’il affirme que l’accès à un avocat est garanti « exception faite du terrorisme qui est régie par des dispositions spéciales[99]. »
Enfin, la loi antiterroriste n°2010-035 demeure particulièrement problématique dans sa définition particulièrement imprécise du terrorisme qui inclut notamment le fait de « pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales de la Nation »[100].
6.4 Indépendance de la justice
L’État partie affirme que « l’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la Constitution »[101]. Il rappelle même que selon l’article 89 de la Constitution, « [l]e pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu’il préside. »
Le corps de la magistrature est régi par la loi organique n°94-012 portant statut de la magistrature et l’Ordonnance n°2006-016 portant modification de certaines dispositions de cette loi. L’exécutif exerce toutefois un rôle prépondérant dans le processus de nomination et d’avancement de carrière des magistrats. Le processus de nomination du Conseil supérieur de la magistrature censé garantir l’indépendance organique des magistrats est entièrement contrôlé par l’exécutif[102]. Par ailleurs, le fait que le président continue de présider le Conseil, tandis que le ministre de la Justice est le vice-président de l’instance, nuit sérieusement aux principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance du pouvoir judiciaire.
Si le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions concernant la nomination des magistrats du siège et du parquet, la nomination du président de la Cour suprême relève uniquement des prérogatives du président de la République selon les termes de l’article 14 de l’Ordonnance n° 2007-012 portant organisation judiciaire.
Recommendations:
- Veiller à ce que les garanties procédurales prévues par la loi contre la torture soient appliquées sans discrimination à toute personne privée de liberté ;
- Assurer le droit d’avoir accès à un conseil dès le moment de l’arrestation ;
- Amender la loi antiterroriste de 2010 afin d’en assurer la conformité avec les principes et garanties prévues par le droit international.
7. Libertés fondamentales (articles 19, 21, 22 et 25 ; points 27 à 30)
L’article 10 de la Constitution consacre la liberté d'opinion et de pensée, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de son choix, la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique. L’article précise que la liberté ne peut être limitée que par la loi, toutefois les lois de mise en œuvre de ces libertés imposent des restrictions disproportionnées affectant la substance de ces droits.
7.1 Libertés d’opinion et d’expression (point numéro 28)
7.1.1 Un cadre juridique restreignant la liberté de la presse
La liberté de la presse repose sur la loi n°2011-054 modifiant l’Ordonnance sur la liberté de la presse n°2006-017, laquelle avait abrogé l’Ordonnance n°91-023 sur la liberté de la presse jugée plus restrictive. Le cadre juridique actuel est moins attentatoire à la liberté d’expression dans la mesure où certaines dispositions contenues dans l’Ordonnance n°2006-017 ne répondant pas aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité ont été abrogées ou modifiées. Il s’agissait des articles 35[103], 36[104], 40[105], 41[106], 44[107], et 45[108] de l’Ordonnance.
Ces articles relatifs aux délits contre la chose publique, contre les personnes et contre les chefs d’État étrangers, fixaient des limites excessives aux contenus publiés par voie de presse et comportaient des sanctions disproportionnées, à savoir des peines de prison ainsi que de lourdes amendes. Le Comité a eu l’occasion de s’inquiéter des « lois régissant des questions telles que le crime de lèse-majesté, […] l’outrage à une personne investie d’une autorité, l’outrage à l’autorité publique, l’offense au drapeau et aux symboles, la diffamation du chef de l’État , et la protection de l’honneur des fonctionnaires et personnalités publique »[109]. En règle générale, le Comité recommande de ne pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la personne qui peut avoir été visée.
L’article premier de la loi n°2011-054 stipule que les dispositions suscitées ont été abrogées. Bien que la loi comporte la suppression des articles 35, 44 et 45, criminalisant l'offense du Président de la République et autres, comme les chefs d'État, les personnalités anonymes, étrangères et nationales, les interdictions prévues aux articles 36, 40 et 41 de l’Ordonnance n°2006-017 demeurent. Seules les peines de prison ont été supprimées et les amendes prévues demeurent inchangées ou augmentées.
D’autre part, l’Ordonnance n°2006-017 comporte toujours des dispositions formulées en des termes vagues et/ou prévoyant des peines de prison pour des actes tombant sous le droit à la liberté d’expression et qui n’ont toujours pas fait l’objet d’un réexamen législatif.
Ainsi, l’article 21 de l’Ordonnance n°2006-017 prévoit toujours l’interdiction de journaux ou écrits périodiques étrangers « lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’Islam ou au crédit de l’État, à nuire l’intérêt général, à compromettre l’ordre et la sécurité publics. » Il convient de relever ici qu’il s’agit d’une disposition vague, sujette à toutes formes d’interprétations. De tels termes dépourvus de définition claire et précise sont autant de motifs de censure.
L’article 33 de la même Ordonnance sanctionne « de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000.000 UM d'amende ceux qui, […], auront directement provoqué, les crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État » quand bien même cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet. Oumar Ould Beibacar a été poursuivi, entre autres, sur la base de cette disposition en raison de ses prises de position publiques sur la question du Passif humanitaire. Il avait été arrêté après une conférence de presse à Nouakchott le 28 novembre 2015, au cours de laquelle il avait accusé les autorités au pouvoir en 1989-1991 d'avoir commis un « génocide » pour lequel elles doivent être traduites en justice[110].
De la même manière, l’article suivant stipule que « [t]oute provocation […] adressée à des militaires ou des agents de la force publique, dans le but de les détourner de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 UM. »
En ce qui concerne les restrictions à la liberté d’expression justifiées par la protection d’autres droits ou de la réputation d’autrui, la diffamation est proscrite à l’article 37 de l’Ordonnance n°2006-017 inspirée de la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 38 prévoit une amende de 500 000 à 1 000 000 UM lorsque la diffamation est dirigée contre les tribunaux, les forces armées et de sécurité, les corps constitués et les administrations publiques.
Cette dernière disposition comporte le risque qu’elle soit employée pour protéger l’État et ses représentants contre l’opinion publique ou la critique. En parallèle, le Code pénal continue de rendre passibles de peines de prison ou d’amendes des activités liées à l’exercice de la liberté d’expression, telles que la diffamation ou l’outrage aux fonctionnaires ou aux institutions de l’État[111].
Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, « aucune action civile ou pénale en diffamation ne sera autorisée à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. De plus, toutes les lois desacato (outrage à magistrat) devraient être abrogées[112]. »
Enfin, l’article 70 de l’Ordonnance n°2006-017 donne au ministre de l'Intérieur et aux autorités administratives locales le droit d’ordonner par arrêté motivé la saisie administrative de tout numéro d'un journal ou écrit périodique, imprimés placards, affiches, films ou dessins dont la publication porte atteinte ou est « susceptible de porter atteinte à l’Islam, à nuire l’intérêt général, à compromettre l’ordre et la sécurité publics ». Cette limitation permet non seulement la mise en œuvre de mesures disproportionnées prises par l’exécutif, mais se fonde également sur des motifs larges.
7.1.2 Atteintes à la liberté de la presse
La Mauritanie est caractérisée par un paysage médiatique diversifié. Il existe plusieurs journaux, radios et chaînes de télévision privées en plus de médias gouvernementaux[113]. Cette situation a été rendue possible grâce à l’adoption de la loi n°045-2010 qui a mis fin au monopole d’État dans le secteur de l’audiovisuel.
Depuis 2014, le pays connaît une régression continue en matière de liberté de la presse selon Reporters sans frontières[114]. En 2019, la Mauritanie est passée du 72ème au 94ème rang au Classement mondial de la liberté de la presse.
Les journalistes travaillant sur des sujets sensibles comme des affaires de corruption impliquant des personnalités publiques voient leurs activités régulièrement entravées.
Le 8 août 2018, la police a procédé à l’arrestation de deux journalistes, Babacar Ndiaye, webmestre du portail d’information Cridem, et Mahmoudi Ould Saibout, journaliste à Taqadoum, suite à une plainte pour diffamation déposée par un avocat basé en France et proche du gouvernement actuel, à propos d’un article qu’ils avaient partagé sur leurs plateformes respectives. L’avocat en question était qualifié de « mercenaire, mêlé à des affaires de mauvaise gouvernance »[115].
M. Ndiaye a déjà fait l’objet de harcèlement judiciaire de la part des autorités mauritaniennes directement lié à ses activités de journaliste dans le passé. Le 7 avril 2016, il avait été convoqué par la police judiciaire et placé en détention à Nouakchott avant d’être libéré sous caution le lendemain. Cette arrestation faisait suite à une plainte pour diffamation déposée par Badr Ould Abdel Aziz, le fils du président de la République[116].
Plus récemment, le 22 mars 2019, les autorités mauritaniennes ont arrêté Abderrahmane Weddady et Cheikh Ould Jiddou, deux blogueurs ayant rédigé des chroniques portant sur un système de corruption présumé dans lequel le président actuel serait impliqué. Les deux blogueurs ont été inculpés le 27 mars de diffamation en vertu de l’article 348 du Code pénal[117].
7.1.3 Lacunes et contradictions dans la lutte contre la discrimination (Article 19 lu conjointement avec les articles 4 et 20 ; point numéros 4 et 5)
L’article 4 de la loi n°2011-054 modifiant l’article 41 de l’Ordonnance n°2006-017 prévoit une peine de prison de six mois en cas d’ « injure envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une région, ou religion déterminée ». Si cette formulation est conforme à l’article 20 du PIDCP, elle est problématique dans sa pratique.
Dans ses réponses à la liste des points, l’État partie affirme que « toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi[118]. » Le gouvernement invoque régulièrement la lutte contre le racisme afin de poursuivre des opposants politiques lorsque ces derniers dénoncent la sous-représentation des Haratines et des Africains subsahariens au sein de l’administration[119].
En outre, l’État partie a adopté la loi « relative à l’incrimination de la discrimination » le 18 janvier 2018. Celle-ci définit la discrimination de la manière suivante en son article premier:
Au sens de la présente loi, la discrimination signifie toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à la charia.
La définition donnée ci-dessus retenue dans le texte final s’éloigne sensiblement des standards internationaux notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination[120]. Les domaines dans lesquels la discrimination peut s’exercer ne sont pas clairement énoncés.
Dans son rapport, l’État partie énonce une définition de la discrimination qui est différente de la définition figurant dans la loi du 18 janvier 2018 citée plus haut[121]. L’État assure que cette deuxième version serait conforme à la définition internationale de la discrimination. Or, les motifs de discrimination mentionnés dans l’article 1er de Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne figurent pas dans la définition mentionnée dans le rapport étatique. En tout état de cause, l’État partie devrait clarifier laquelle des deux définitions est actuellement applicable.
L’État partie affirme dans ses réponses à la liste des points que « l’article 11 de la loi n° 2018-023 incriminant la discrimination, prévoit la discrimination à raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie ou une race[122]. »
Cependant, il convient de noter que cette disposition ne peut être considérée comme une modification de la définition de la discrimination dans la mesure où elle pénalise certes l’incitation à la discrimination, mais aussi l’incitation à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes[123]. La définition de la discrimination telle qu’énoncée dans l’article 1er de la loi n° 2018-023 reste donc inchangée.
Plusieurs rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme ont estimé que le manque de précisions pouvait engendrer « des dérives dans l’interprétation de ces articles, conduisant à la violation de plusieurs droits et libertés reconnus dans le droit international des droits de l’homme et par la Mauritanie »[124].
En outre, l’article 10 de la loi stipule que « [q]uiconque encourage l'incitation à la haine contre la doctrine officielle de la République islamique de Mauritanie sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du Code Pénal ».
Les rapporteurs spéciaux ont insisté sur le manque de précision de l’expression « incitation à la haine contre la doctrine officielle de la République islamique de Mauritanie»[125]. En effet, cette disposition englobe les critiques envers la situation politique et la conduite du gouvernement ou des agents gouvernementaux. En outre, plutôt que de recourir au droit pénal, l’État partie devrait davantage privilégier des mesures relevant du droit civil et administratif lorsque des sanctions moins sévères permettaient d'atteindre le but recherché.
Ces inquiétudes ont également été partagées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale lequel a recommandé à l’État partie de « réviser sa nouvelle loi relative à l’incrimination de la discrimination afin de la rendre pleinement conforme à la Convention (CERD) »[126].
Un exemple illustrant l’emploi inapproprié des dispositions anti-discrimination est l’arrestation d’Abdallahi Salem Ould Yali le 24 janvier 2018. Il a été inculpé d'incitation à la violence et à la haine raciale pour des messages qu'il avait affichés sur les réseaux sociaux et dans lesquels il dénonçait la discrimination raciale en Mauritanie. Il a été poursuivi pour avoir « [incité] les citoyens à s’armer contre l'autorité de l'État ou à s’armer les uns contre les autres » sur la base de l’article 83 du Code pénal. Il est également poursuivi pour « incitation à la violence ou à la haine raciale » pour avoir « insulté une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou un groupe de personnes qui se distinguent par une de ces caractéristiques ». Il fut également inculpé en vertu de la loi antiterroriste de 2010, qui inclut dans ses définitions d'un acte terroriste le fait « d’inciter au fanatisme ethnique, racial ou religieux »[127].
7.1.4 Criminalisation de l'apostasie et du blasphème
L’Assemblée nationale a adopté le 27 avril 2018 un projet de loi abrogeant et remplaçant l'article 306 de l'Ordonnance portant Code pénal[128]. Le texte a durci les peines prévues en matière de blasphème et d'apostasie. Les auteurs reconnus coupables sont désormais systématiquement passibles de la peine de mort[129]. La loi prévoit également une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende de 600’000 ouguiyas (environ 13’804 euros) au maximum pour « atteinte à la décence publique et aux valeurs de l’islam » et « non-respect des interdictions prescrites par Allah » ou facilitation de leur non-respect.
Non seulement la réforme est contraire à l’article 6 du PIDCP consacrant le droit à la vie, mais contrevient également aux droits à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et de religion ainsi qu’aux libertés nécessaires à la création artistique et sur le droit de participer à la vie culturelle, garantis par les articles 18 et 19 du PIDCP et par l’article 15 du PIDESC.
Il convient de rappeler ici que l’Observation générale n° 34 relative à l’article 19 du PIDCP dispose que les « interdictions des manifestations de manque de respect à l’égard d’une religion ou d’un autre système de croyance, y compris les lois sur le blasphème, sont incompatibles avec le Pacte, sauf dans les circonstances spécifiques envisagées au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte »[130].
7.2 Libertés d’assemblée et de réunion pacifique (point numéro 28)
Le droit de réunion en Mauritanie est régi par la loi n°73-008 sur les réunions publiques qui stipule que « [l]es réunions publiques sont libres sous réserve des conditions prescrites par la loi. ». L’article 3 précise que « [t]oute réunion publique doit faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités administratives habilitées au moins trois jours francs avant la date de la réunion » et qu’« [a]ucune réunion ne peut être tenue sur la voie publique. » Les infractions à cette loi sont punies de peines d’emprisonnement allant de deux à six mois.
La loi n°73-008 ne définit pas les conditions et la procédure d’interdiction d’une réunion par les autorités, ni n’établit explicitement que la décision puisse faire l’objet d’un recours devant une juridiction impartiale et indépendante[131].
Sur cette base, le Ministère de l’Intérieur a annoncé dans une circulaire datée du 11 février 2016 que « sans l’autorisation préalable du Hakem (préfet), il est formellement interdit d’organiser aucun spectacle, conférence, cérémonie, fête ou autre manifestation où le public est admis »[132].
Le droit mauritanien comporte néanmoins une exception concernant les partis politiques agréés, ces derniers pouvant tenir des réunions ou des manifestations sans requérir une autorisation préalable[133].
Ainsi l’État partie n’adopte pas de système de notification ayant pour objet de protéger le caractère pacifique des assemblées, mais un système d’autorisation préalable. Il convient de rappeler que selon le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, les associations devraient pouvoir fonctionner sans avoir à subir d’ingérence injustifiée, même lorsqu’elles ne sont pas autorisées officiellement[134].
Par conséquent, les assemblées et réunions non autorisées sont criminalisées sous l’article 101 paragraphe 2 du Code pénal qui prévoit l’interdiction de « tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. » Les peines prévues par le Code pénal vont de deux mois à un an contre toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas quitté après la première sommation.
La criminalisation des assemblées et réunions non autorisées donne également lieu à un usage de la force souvent disproportionné pour les disperser – que les assemblées soient pacifiques ou non. Ainsi, à l’issue de sa visite, le Rapporteur spécial contre la torture a estimé que les méthodes habituellement employées en marge des manifestations étaient contraires aux principes internationaux relatifs au maintien de l’ordre, et il est fréquent que des manifestants pacifiques soient blessés[135]. De la même manière, à l’issue de l’examen du rapport initial de la Mauritanie, le Comité des droits de l’homme a recommandé à l’État partie d’ « assurer la protection des manifestations pacifiques organisées sur son territoire et, en cas de violations, mener des enquêtes aux fins de poursuite des responsables »[136].
L’État partie affirme qu’une enquête judiciaire a été menée par une autorité concernant l’affaire Mangane[137]. Lamine Mangane était un défenseur des droits humains qui a été tué par balle au cours d’une manifestation pacifique organisée à Maghama par l’organisation « Touche pas à ma nationalité » le 27 septembre 2011. Selon ses proches, aucune enquête n’a été menée et personne n’a été traduit en justice. La plainte déposée par sa famille a par ailleurs été classée sans suite[138].
Ces restrictions à la liberté de rassemblement et de réunion pacifiques affectent autant les opposants politiques que les défenseurs des droits de l’homme. À l’approche du référendum constitutionnel qui s’est tenu le 5 août 2017, la porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU s’est dite préoccupée par « l’apparente répression de la dissidence par les autorités ainsi que par les informations faisant état de l’emploi d’une force excessive contre les organisateurs de manifestations ». En effet, les autorités n’ayant pas donné suite aux demandes d’autorisation déposées par les opposants aux textes pour les manifestations, la police et la gendarmerie ont procédé à la dispersion de ces rassemblements en recourant à une force excessive et en procédant à des arrestations[139].
Par ailleurs, les manifestations organisées par l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), principale organisation non-reconnue de la société civile mauritanienne luttant contre l’esclavage, sont régulièrement dispersées avec un usage non nécessaire et disproportionné de la force. Le 11 novembre 2014, trois militants du mouvement IRA dont son président, Biram Dah Abeid, ont été arrêtés à Rosso alors qu’ils organisaient une caravane à travers le pays pour tenir des conférences afin de dénoncer « l'esclavage foncier ». Le 15 janvier 2015, ils ont été condamnés par le tribunal de Rosso à deux ans d’emprisonnement pour « appartenance à une organisation non reconnue » et « rassemblement non autorisé ». Plusieurs rapporteurs spéciaux ont adressé une communication à l’État partie concernant de possibles violations des articles 19, 21 et 22 du Pacte[140].
7.3 Liberté d’association (point numéro 28)
À l’issue de l’examen du rapport initial de la Mauritanie par le Comité des droits de l’Homme, l’État partie avait été appelé à « adopter une nouvelle loi régissant l’exercice de la liberté d’association conforme aux normes internationales et offrant la protection requise aux défenseurs des droits de l’homme»[141]. Les autorités n’ont toujours pas modifié la loi relative aux associations n°64/098 afin d’en assurer la conformité avec l’article 22 du PIDCP. En effet, l’article 3 de la loi n°64/098 dispose que « [l]es associations de personnes ne pourront se former ou exercer leurs activités sans une autorisation préalable délivrée par le Ministre de l’Intérieur ». La loi n’oblige pas non plus à communiquer une décision par écrit, ni à veiller à ce qu’elle soit motivée par des fondements juridiques conformes au droit international relatif aux droits humains, ni encore à ce que la décision puisse être contestée devant un tribunal[142].
L’État partie n’a toujours pas mis en place un régime de notification ne revêtant pas de caractère discrétionnaire. Bien au contraire, un projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations modifiant la loi relative aux associations de 1964 a été adopté en conseil des ministres le 22 juillet 2015 sans aucune consultation publique. L’État partie indique que le texte est en instance de soumission au Parlement pour adoption[143].
Le projet de réforme maintient l’obligation, institué dans la loi cadre de 1964, pour les associations d’obtenir une autorisation afin de pouvoir fonctionner[144]. L’État partie indique dans ses écritures que les organisations à vocation territoriale communale ou départementale sont autorisées par le Hakem (ou préfet[145]) compétent territorialement tandis que les organisations à vocation nationale doivent demander une autorisation auprès du Ministère de l’Intérieur[146].
L’article 6 du projet de loi prévoit notamment qu’ « aucune association ne peut être créée sur une base ou pour un objectif contraire à l’islam, à la Constitution, aux lois en vigueur ou pour des activités de nature à porter atteinte à la sécurité des citoyens, à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine de l'État ou aux bonnes mœurs ».
En août 2015, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association avait appelé l’Assemblée nationale à rejeter le projet de loi au motif que le manque de précision de certaines définitions et critères déterminants pour l’enregistrement d’associations pourrait permettre aux autorités de procéder à des rejets d’arbitraires de demandes et que le texte ne prévoirait pas explicitement de voie de recours pour contester une décision[147]. »
Malgré l’absence d’un régime déclaratoire, la Mauritanie compte plusieurs milliers d’ONG. Pas moins de 7'000 ONG locales se sont inscrites au sein de la Plateforme de la société civile mise en place par le gouvernement[148].
En revanche, les ONG travaillant sur des sujets considérés comme sensibles par les autorités, comme la lutte contre les pratiques esclavagistes, le racisme, le droit à la vérité relatif au « passif humanitaire », peinent à régulariser leur situation. Par exemple, le « Mouvement IRA », Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, « Touche pas à ma nationalité », « l’Association des veuves mauritaniennes » et l’« l’Union des Jeunes Volontaires », ne sont toujours pas reconnues.
Partant, les militants du mouvement IRA font régulièrement l’objet d’intimidations et de représailles liées à leurs activités de défenseurs des droits humains. Entre le 30 juin et le 9 juillet 2016, 13 membres de l’IRA ont été arrêtés avant d’être inculpé d’ « attroupement armé », d’ « utilisation de la violence à l’égard d’agents de la force publique », « rébellion » et « appartenance à une organisation non reconnue »[149].
Ces accusations portaient sur des affrontements survenus le 29 juin 2016 après que la police a tenté d'expulser les habitants de la « Gazra Bouamatou », un quartier déshérité de Nouakchott majoritairement habité par des membres de la communauté Haratine[150], avant la tenue d'un sommet de la Ligue arabe dans la ville. Bien que les membres de l’IRA aient nié leur implication dans des affrontements avec la police, les militants de l’IRA ont été condamnés, le 18 août 2016, à de lourdes peines de prison allant de trois à 15 ans de prison à la suite d’un procès dont les irrégularités ont été relevées par plusieurs titulaires de mandats relevant des procédures spéciales[151]. En effet, l’équité du procès a été remise en cause par le fait que des allégations de tortures n’ont pas fait l’objet d’une enquête prompte et impartiale et que les faits reprochés aux activistes se référaient à leurs activités de défense des droits humains. À l’inverse, le tribunal a rejeté la plainte déposée par les activistes pour les actes de tortures qui leur avaient été infligées en détention.
7.4 Droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu (article 25 ; point numéro 29 et 30)
Les partis politiques sont régis par l’Ordonnance n°91-024 relative aux partis politiques. L’article 8 stipule que pour être valablement constitué, un parti politique doit en faire déclaration auprès du Ministère de l’Intérieur. Cette déclaration s’effectue par un dépôt d’un dossier moyennant la délivrance d’un récépissé par l’autorité compétente. La reconnaissance officielle d’un parti est faite à partir de la publicité du récépissé au Journal officiel[152].
En cas de non-délivrance de récépissé au moment de la déclaration. L’absence de réponse positive explicite équivaut à un refus sur le principe de pouvoir discrétionnaire de l’administration publique. En d’autres termes, le système déclaratoire mis en place par la loi équivaut en pratique à un régime d’autorisation entièrement contrôlé par l’exécutif.
Par le passé, des partis politiques n’ont pas été autorisés à poursuivre leurs activités soit parce que le parti portait atteinte à l’unité nationale, soit parce que le parti était considéré comme « islamiste »[153]. Des récépissés n’ont également pas été délivrés au motif qu’il y avait déjà beaucoup de partis politiques ou encore sur la base de l’article 6 de l’Ordonnance 91.24 du 25 juillet 1991, selon laquelle « aucun parti ou groupement politique ne peut s’identifier à une race, à une ethnie, à une région, à une tribu, à un sexe ou à une confrérie ». Ce fut notamment le cas de l’IRA qui a déposé une demande d’autorisation pour fonder un parti politique sous le nom du Parti radical pour une action globale, demande refusée par le directeur général des élections et des libertés civiles du ministère de l’Intérieur[154].
Le 21 juin 2018, le parlement a adopté un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n°2012-024 modifiant l’Ordonnance n°91-24 régissant les partis politiques. Le texte prévoit la dissolution des partis politiques ayant boycotté au moins deux élections, ce qui risque d’impacter principalement les partis d’oppositions pour lesquels le boycott est un moyen de dénoncer l’impartialité des processus électoraux[155]. En effet, plusieurs partis d’opposition avaient décidé de boycotter les élections législatives de 2013.
Par ailleurs, la campagne ayant précédé les élections législatives, régionales et locales du 1er septembre 2018 a été marquée par l’arrestation du militant anti-esclavagiste et candidat aux élections législatives, Biram Dah Abeid. Ce dernier avait été arrêté le 7 août 2018. Lors de sa garde à vue, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avait validé sa candidature. Il a été inculpé le 13 août 2018 « d’incitation à la violence et menace portée sur la vie des personnes ». Il a été libéré de prison le 1er janvier 2019, après que les charges portées contre lui eurent été abandonnées[156]. Son arrestation ainsi que les poursuites retenues contre lui précédant une détention préventive de près de cinq mois ont constitué non seulement une détention arbitraire, mais également une atteinte sérieuse à l’exercice de son droit de prendre part à la direction des affaires publiques.
Recommendations:
- Réformer le Code pénal et les autres législations applicables afin de mettre fin à la criminalisation des actes d’expression pacifique;
- Définir l’infraction terroriste de manière claire, précise et prévisible, conformément aux standards internationaux ;
- Amender la législation relative à l’incrimination de la discrimination afin de veiller à ce que les défenseurs des droits humains travaillant sur cette question ne fassent plus l’objet de poursuites ;
- Respecter le droit de réunion pacifique en permettant la tenue des rassemblements publics à travers un régime de type déclaratif ;
- Prévenir tout usage d’une force excessive par les forces de l’ordre pour disperser les manifestants, et procéder à des enquêtes promptes et impartiales suite à de tels actes ;
- Adopter un régime déclaratif pour les organisations non gouvernementales et les associations, et mettre fin à la discrimination contre les associations travaillant dans la lutte contre la discrimination raciale et contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes.
[1] Réponses de la Mauritanie à la liste de points concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 30 avril 2019, CCPR/C/MRT/Q/2/Add.1, (ci-après « Réponse de l’État à la liste des questions »).
[2] Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, 21 novembre 2013, CCPR/C/MRT/CO/1, (ci-après, «Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le rapport initial de la Mauritanie»).
[3] Commentaires sur la communication conjointe de procédures spéciales relatives à la nouvelle loi incriminant la discrimination, 9 avril 2018, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34000 (consulté le 11 février 2019).
[4] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 2.
[5] Ibid., § 1.
[6] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 3.
[7] Al Akhbar, Mauritanie: Nomination des membres du Haut conseil de la Fatwa et des recours gracieux
[8] United States Department of State, Rapport 2015 sur les droits de l’homme –Mauritanie, https://photos.state.gov/libraries/mauritania/231771/PDFs/MAURITANIA-IRF-2015-FRE-Final.pdf (consulté le 20 mai 2019).
[9] Comité des droits de l’homme, Deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2017– Mauritanie, 22 novembre 2017, CCPR/C/MRT/2, (ci-après, « Deuxième rapport périodique de la Mauritanie »), § 49.
[10] Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, Rapport et recommandations de la session du Sous-comité d'accréditation – octobre 2018, pp. 26-30.
[11] Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, Rapport et recommandations de la session du Sous-comité d'accréditation – novembre 2017, p. 23.
[12] Rapport et recommandations de la session du Sous-comité d'accréditation – octobre 2018, p. 27.
[13] Ibid.
[14] Voir question 17 b) de la Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie.
[15] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 52.
[16] Ibid., p. 28.
[17] Commission nationale des droits de l’homme, Rapport sur la situation des chaines de télévisions privées en Mauritanie, https://www.cndh-mr.com/index.php/190-rapport-sur-la-situation-des-chaines-de-televisions-privees-en-mauritanie (consulté le 23 janvier 2019).
[18] Reporters sans frontières, Mauritanie, https://rsf.org/fr/mauritanie (consulté le 23 janvier 2019).
[19] CRIDEM, Communiqué de la CNDH sur les propos blasphématoires tenus à l’encontre du prophète (PSL), 7 janvier 2014, http://www.cridem.org/C_Info.php?article=651667 (consulté le 10 avril 2019).
[20] Irabiha Abdel Wedoud, Le coup d'État, un espoir pour nous, les Mauritaniens, L’Obs, 17 août 2008, https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20080817.RUE5350/le-coup-d-État-un-espoir-pour-nous-les-mauritaniens.html (consulté le 10 avril 2019).
[21] Rapport et recommandations de la session du Sous-Comité d'accréditation – octobre 2018, p. 29.
[22] Article 3 de la loi n°2015-034 instituant un mécanisme national de lutte et de prévention de la torture.
[23] Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, Visite en Mauritanie du 24 au 28 octobre 2016 : observations et recommandations adressées au mécanisme national de prévention, 24 septembre 2018, CAT/OP/MRT/2, § 4.
[24] Ibid., § 28.
[25] Ibid., § 47.
[26] Ibid., §§ 56-57.
[27] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 69.
[28] Pour plus d’informations voir : Office of the High Commissioner for Human Rights, Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association; du Rapporteur spécial sur le droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible; du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme; de la Rapporteuse spéciale sur l'indépendance des juges et des avocats; du Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Référence : UA MRT 2/2016, 11 octobre 2016.
[29] La déclaration de M. Boubacar Ould Messaoud est disponible ici : http://cridem.org/C_Info.php?article=686424 (consulté le 22 mai 2019).
[30] Sidi N’Diaye, « Mémoire et réconciliation en Mauritanie », Cahiers d’études africaines [En ligne], 197 | 2010, mis en ligne le 10 mai 2012, http://journals.openedition.org/etudesafricaines/15782 (consulté le 24 janvier 2019).
[31] Human Rights Watch, « Campagne de terreur en Mauritanie ; La campagne de répression des Noirs africains soutenue par l’État », New York, Human Rights Watch, 1994, http://pantheon.hrw.org/legacy/french/reports/mauritania/mauritania.htm (consulté le 28 janvier 2019).
[32] L’article 2 de la loi n°93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie stipule que: « Toute plainte, tout procès-verbal et tout document d’enquête relatifs à cette période et concernant une personne ayant bénéficié de cette amnistie, sera classée sans suite.
[33] Comité des droits de l’homme, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes crées en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 29 juillet 1994, HRI/GEN/1/Rev.1, p. 30.
[34] Deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op.cit., § 193.
[35] Ibid., § 194.
[36] Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales concernant les huitième à quatorzième rapports périodiques de la Mauritanie, 11 mai 2018, §§ 24-25 (ci-après «Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale concernant les huitième à quatorzième rapports périodiques de la Mauritanie»).
[37] Fondation Alkarama, Mauritanie : un militant de la lutte contre l'impunité menacé et persécuté par les autorités, 12 août 2015, https://www.alkarama.org/fr/articles/mauritanie-un-militant-de-la-lutte-contre-limpunite-menace-et-persecute-par-les-autorites (consulté le 28 janvier 2019).
[38] Human Rights Committee, General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, adopted on 30 October 2018, CCPR/C/GC/36, §§ 36-55.
[39] Ibid. § 35.
[40] Ibid., § 37.
[41] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 41.
[42] Articles 353, 354, 410, 411 du Code pénal.
[43] Article 307 du Code pénal.
[44] Article 306 du Code pénal.
[45] Article 308 du Code pénal.
[46] Articles 67-69, 88, 90, 92, 95, 96, 122 du Code pénal.
[47] Articles 69 et 70 du Code pénal.
[48] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 44.
[49] Ibid., § 43.
[50] Human Rights Watch, Mauritanie : Peine de mort obligatoire en cas de blasphème, 4 mai 2018, https://www.hrw.org/fr/news/2018/05/04/mauritanie-peine-de-mort-obligatoire-en-cas-de-blaspheme (consulté le 21 mai 2019).
[51] Voir Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis n° 35/2017, concernant Mohammed Shaikh Ould Mohammed Ould M. Mkhaitir (Mauritanie), adopté le 27 avril 2017, A/HRC/WGAD/2017/35.
[52] Observation générale n° 34, Libertés d’opinion et d’Expression (Article 19), op. cit, § 48.
[53] Comité contre la torture, Compte rendu analytique de la 1659e séance, 17 août 2018, CAT/C/SR.1659, § 42.
[54] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 45.
[55] Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Des experts des Nations Unies demandent la libération immédiate d’un bloggeur mauritanien détenu, 8 mai 2018, https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23050&LangID=F (consulté le 21 mai 2019).
[56] Article 17 de la loi n°2010-035 du 21 Juillet 2010 Abrogeant et Remplaçant la loi n°2005-047 du 26 Juillet 2005 relative à la Lutte contre le Terrorisme.
[57] Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 6 août 2018, CAT/C/MRT/CO/2, (ci-après, «Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie »), § 10.
[58] Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, 21 novembre 2013, CCPR/C/MRT/CO/1, § 14 (Ci-après « Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le rapport initial de la Mauritanie »).
[59] Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission en Mauritanie, 13 décembre 2016, A/HRC/34/54/Add.1, (ci-après « Rapport de visite du SRT sur sa mission en Mauritanie »).
[60] United States Department of State, Rapport 2017 sur les droits de l’homme –Mauritanie, https://mr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/204/MAURITANIA-HRR-2017-FRE-FINAL.pdf (consulté le 29 janvier 2019).
[61] Rapport de visite du SRT sur sa mission en Mauritanie, op.cit., § 18.
[62] Ibid., § 21.
[63] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 51.
[64] Rapport de visite du SRT sur sa mission en Mauritanie, op.cit., § 92.
[65] Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 16.
[66] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 57.
[67] Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite, 8 juin 2016, CAT/C/SAU/CO/2, § 10 ; Comité contre la torture, Alhaj Ali c. Maroc, Communication n° 682/2015, 3 août 2016, CAT/C/58/D/682/2015, § 8.5.
[68] Comité contre la torture, Compte rendu analytique relatif à l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, 6 août 2018, CAT/C/SR.1656, § 25.
[69] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 66.
[70] Deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit., § 151.
[71] Statistiques fournies par l’État partie dans le cadre de ses réponses à la liste de points concernant le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité contre la torture, p 12.
[72] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 66.
[73] Deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit., § 153.
[74] Ibid., §§ 151-158
[75] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 63
[76] Ibid., §§ 140-152.
[77] Ibid., §§ 140-150.
[78] Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op.cit, § 49.
[79] Mécanisme national de prévention de la torture, Rapport alternatif du Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP) de Mauritanie adressé à la 64éme session du Comité Contre la Torture (CAT), p. 6.
[80] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, §§ 65-67.
[81] Echange entre MENA Rights Group et Mme Fatimetou Mohamed Salek, présidente de l’ONG Assistance aux femmes et enfants difficulté (ASFED), le 14 mai 2019.
[82] Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of Mauritania, 26 November 2018, CRC/C/MRT/CO/3-5, § 44.
[83] Rapport 2017 sur les droits de l’homme –Mauritanie, op. cit, p. 5.
[84] L’article 4 de la dispose que : « Dès l’instant où intervient la privation de liberté d’une personne, des garanties fondamentales doivent être appliquées, notamment :
Le droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informée de sa détention et de son lieu de détention ;
Le droit, à sa demande, à un examen par un médecin dès son admission, arrestation ou internement ;
Le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou à l’assistance d’une personne de son choix ainsi que la possibilité d’avoir rapidement accès à une aide judiciaire le cas échéant ;
Le droit d’être présentée sans délai à un juge et de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention conformément aux lois en vigueur ;
Le droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend, des droits ci-dessus énumérés ainsi que la possibilité de solliciter l’aide judiciaire ;
L’obligation pour l’autorité de détention de tenir un registre à jour indiquant notamment l’identité et l’état physique et sanitaire de la personne privée de liberté, la date , l’heure et le motif de la privation de liberté, la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert ;
L’inobservation de ces garanties fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales s’il y a lieu ».
[85] Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le rapport initial de la Mauritanie, op. cit, § 18.
[86] Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 8.
[87] Article 57 du Code de procédure pénale.
[88] Article 58 du Code de procédure pénale.
[89] Compte rendu analytique relatif à l’examen du deuxième rapport périodique par le Comité contre la torture, op. cit, § 5.
[90] Ibid.
[91] Rapport de visite du SRT, op.cit., §79.
[92] Ibid., § 18.
[93] Ibid., § 56.
[94] Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis n° 33/2018, concernant Mohamed Ould Ghadde (Mauritanie), adopté le 25 avril 2018, A/HRC/WGAD/2018/33, § 54.
[95] Communications no 702/1996, McLawrence c. Jamaïque, § 5.6; no 2120/2011, Kovalev c. Bélarus, § 11.3.
[96] Communications no 1128/2002, Marques de Morais c. Angola, § 6.3; no 277/1988, Terán Jijón c. Équateur, § 5.3 (un délai de cinq jours n’est pas considéré comme bref); no 625/1995, Freemantle c. Jamaïque, § 7.4 (un délai de quatre jours n’est pas considéré comme bref).
[97] Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 8.
[98] Compte rendu analytique relatif à l’examen du deuxième rapport périodique par le Comité contre la torture, op. cit, § 6.
[99] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 69.
[100] Article 3 de la loi n°2010-035 du 21 juillet 2010 Abrogeant et Remplaçant la loi n°2005-047 du 26 juillet 2005 relative à la Lutte contre le Terrorisme.
[101] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 84.
[102] L’article 4 de l’Ordonnance n°016-2006 stipule que : « les nominations des magistrats aux divers emplois de la magistrature sont faites suivant leur grade et leur ancienneté au sein de ces grades, par décret du président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège et par arrêté du Ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats du Ministère public. »
[103] L’article 35 de l’Ordonnance n°017-2006 prévoyait que : « L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 32 est punie d'une amende de 200.000 à 2.000.000 UM. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.»
[104] L’article 36 de l’Ordonnance n°017-2006 prévoyait que : « La publication, la diffusion, ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une peine de prison de trois mois au plus ou d’une amende de 500.000 à 3.000. 000 UM. Les mêmes faits seront punis de six mois de prison et de 5000 000 UM d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation. »
[105] L’article 40 de l’Ordonnance n°017-2006 prévoyait que : « La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 32 sera punie d’un emprisonnement de quinze jours au plus et d'une amende de 400.000 à 1.000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300.000 à 10.000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
[106] L’article 41 de l’Ordonnance n°017-2006 prévoyait que : « L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 38, 39 et 40 de la présente Ordonnance, sera punie d’un emprisonnement de dix jours au plus et d'une amende de 300.000 à 900.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non- appartenance à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
[107] L’article 44 de l’Ordonnance n°017-2006 prévoyait que : « L'offense commise publiquement envers les chefs d’État étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d’un gouvernement étranger sera punie d'une amende de 300.000 à 3.000.000 UM. »
[108] L’article 45 de l’Ordonnance n°017-2006 prévoyait que : « L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 200.000 à 2.000.000 UM. »
[109] Comité des droits de l’Homme, Observation générale n° 34, Libertés d’opinion et d’Expression (Article 19), CCPR/C/GC/34, 12 septembre 2011, (ci-après : « Observation générale n° 34») § 38.
[110] Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges, op. cit.
[111] L’article 348 du Code pénal prévoit que : « Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse, contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 UM. »
[112] Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, M. Frank La Rue, 23 novembre 2010, A/HRC/14/23, § 82.
[113] United States Department of State, Rapport 2018 sur les droits de l’homme –Mauritanie https://mr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/204/MAURITANIA-HRR-2018-FRE-FINAL.pdf (consulté le 22 mai 2019).
[114] Classement mondial de la liberté de la presse 2019 établi par Raporters sans frontières disponible ici : https://rsf.org/fr/classement (consulté le 28 mai 2019).
[115] L’article en question est disponible ici : https://mondafrique.com/mauritanie-jemal-mohamed-taleb-le-mercenaire/ (consulté le 14 février 2019).
[116] Reporters sans frontières, RSF appelle la justice de Mauritanie à utiliser la loi sur la presse plutôt que le Code pénal, 13 avril 2016, https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-la-justice-de-mauritanie-utiliser-la-loi-sur-la-presse-plutot-que-le-code-penal (consulté le 14 février 2019). Le plaignant avait été mis en cause dans un article publié sur le site internet du Cridem qui relayait des informations relatives à des suspicions que Badr Ould Abdel Aziz aurait tiré un coup de feu sur un berger
[117] Human Rights Watch, Mauritanie : Deux blogueurs détenus pour diffamation, 30 mars 2019, https://www.hrw.org/fr/news/2019/03/30/mauritanie-deux-blogueurs-detenus-pour-diffamation, (consulté le 16 avril 2019).
[118] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 26.
[119] Rapport 2017 sur les droits de l’homme – Mauritanie, op. cit, p.11.
[120] A noter que le droit islamique auquel la définition se réfère n’est pas exhaustif en l’espèce. En effet, il existe un Hadith selon lequel « il n'y a pas de mérite pour l'arabe sur le non arabe, ni pour le non arabe sur l'arabe, ni pour blanc sur le noir, ni pour noir sur le blanc, sauf par la piété ».
[121] Au paragraphe 90 du rapport de l’État partie, il est mentionné que le projet de loi incriminant la discrimination, approuvé par le Gouvernement, définit ce phénomène et dispose en son article 1 que : « la discrimination signifie toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale. »
[122] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 21.
[123] L’article 11 de la loi n°2018-023 stipule que « quiconque incite à la discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas ».
[124] Office of the High Commissioner for Human Rights, Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, Référence : OL MRT 5/2017, 24 janvier 2018, p. 7.
[125] Ibid.
[126] Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale concernant les huitième à quatorzième rapports périodiques de la Mauritanie, op. cit, § 8.
[127] Human Rights Watch, Mauritanie : Un activiste inculpé pour avoir dénoncé le racisme, 21 septembre 2018, https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/21/mauritanie-un-activiste-inculpe-pour-avoir-denonce-le-racisme (consulté le 12 février 2019).
[128] Agence mauritanienne d’information, L'Assemblée Nationale adopte un projet de loi abrogeant et remplaçant l'article 306 de l'ordonnance portant Code pénal, 27 avril 2018, http://fr.ami.mr/Depeche-44501.html (consulté le 16 avril 2019).
[129] Déclaration publique conjointe, Mauritanie. Peine de mort obligatoire en cas de blasphème, 4 mai 2018. Office des Nations Unies à Genève, Le comité pour l’élimination de la discrimination raciale examine le rapport de la Mauritanie, 2 mai 2018, https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/8AB7FEEC93D85D9BC1258281004303F3?OpenDocument&cntxt=2AF27&cookielang=fr (consulté le 25 juin 2018). Cet article est également contraire aux normes du droit islamique en ne prévoyant pas de « droit au repentir » pourtant inclus dans les interprétations les plus conservatrices sur l’apostasie. Dans tous les cas la criminalisation du blasphème ne saurait être compatible avec les articles 18 et 2 du Pacte.
[130] Observation générale n° 34, op. cit. § 48.
[131] Amnesty International, « Une épée au-dessus de nos têtes », 2018, Le Rapport est disponible ici : https://www.amnesty.org/fr/documents/afr38/7812/2018/fr/ (consulté le 17 avril 2019.)
[132] Hakem de Tevragh Zeina, circulaire nº 00000072/WNO/MTZ du 11 février 2016.
[133] Rapport 2017 sur les droits de l’homme –Mauritanie, op. cit, p. 13.
[134] Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’expression, Maina Kiai, 21 mai 2012, A/HRC/20/27, §§ 63-66.
[135] Rapport de visite du SRT, op. cit, § 29.
[136] Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le rapport initial de la Mauritanie, op. cit. § 22.
[137] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 46.
[138] Voir « Une épée au-dessus de nos têtes » op. cit, p. 27 et FIFDH, Critiquer la gouvernance : un exercice risqué, 12 décembre 2012, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/MRT/INT_CCPR_NGO_MRT_14503_E.pdf (consulté le 21 mai 2019).
[139] Office of the High Commissioner for Human Rights, Mauritanie : Commentaire de la porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Ravina Shamdasani, 3 août 2017, https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21933&LangID=F (consulté le 13 février 2019).
[140] Office of the High Commissioner for Human Rights, Mandats du Groupe de Travail sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques; et du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Reference: UA MRT 1/201.
[141]Ibid.
[142] « Une épée au-dessus de nos têtes », op. cit, p. 29.
[143] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 133.
[144] Amnesty International, Mauritanie. Une nouvelle loi compromet l’exercice du droit à la liberté d’association, 2 juin 2016, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/06/mauritanie-une-nouvelle-loi-compromet-lexercice-du-droit-a-la-liberte-dassociation/ (consulté le 12 février 2019).
[145] Représentant du gouvernement central.
[146] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 134.
[147] Office of the High Commissioner for Human Rights, Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association; et du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Référence : MRT 3/2015, 7 août 2015.
[148] Rapport 2017 sur les droits de l’homme –Mauritanie, op. cit, p. 14.
[149] Office of the High Commissioner for Human Rights, Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association; du Rapporteur spécial sur le droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible; du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme; de la Rapporteuse spéciale sur l'indépendance des juges et des avocats; du Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Référence : UA MRT 2/2016, 11 octobre 2016.
[150] Human Rights Watch, Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges, 12 février 2018, https://www.hrw.org/fr/report/2018/02/12/ethnicite-discrimination-et-autres-lignes-rouges/repression-lencontre-de (consulté le 14 février 2019).
[151] Op. cit, UA MRT 2/2016.
[152] College of Liberal Arts and Science, Le système des partis politiques et des candidatures, Trans-Saharan Elections Project, https://tsep.africa.ufl.edu/le-systeme-des-partis-politiques-et-des-candidatures/mauritanie/?lang=fr (consulté le 17 avril 2019).
[153] Ibid.
[154] « Une épée au-dessus de nos têtes », op. cit, p.41.
[155] Lemine Ould M. Salem, Impasse politique en Mauritanie, OrientXXI, 13 mars 2012, https://orientxxi.info/magazine/impasse-politique-en-mauritanie,0427 (consulté le 14 février 2019).
[156]Front Line Defenders, Détention du défenseur des droits humains anti-esclavagiste Biram Dah Abeid, https://www.frontlinedefenders.org/fr/case/detention-anti-slavery-human-rights-defender-biram-dah-abeid (consulté le 14 février 2019).